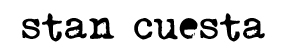Après avoir connu un énorme succès, comparable à celui des susnommés, quasi-ininterrompu entre 1964 et 1966 (« You Really Got Me », « All Day and All of the Night », « Well Respected Man », « Sunny Afternoon », j’en passe…), dès 1967, époque où Ray écrit probablement ses plus belles chansons (« Waterloo Sunset », « Days »), le groupe commence à plonger. Personne ne veut de ces chroniques amères de l’Angleterre, en plein Flower Power psychédélique californien. Pire : ils retrouvent le succès en 1970 avec « Lola », pour tout foirer ensuite dans une de leur période les plus noire, à coup de concept-albums théâtraux indigestes. Et puis, en 1977, ils « deviennent » américains, gros succès aux US (et nulle part ailleurs), tournées des stades et compagnie. Toujours en dehors des modes, n’acquérant jamais le statut des Beatles, Stones, Who et autres qu’ils ont souvent précédés, voire inspirés (« See My Friends », le virage psyché indianisant, bien avant tout le monde, qui fit baver Lennon, Townshend et consort). Pourquoi ? Peut-être simplement, parce que là où Mick Jagger est un performer doublé d’un homme d’affaire redoutable, Ray Davies n’est qu’une sorte de dandy poète, qui a passé une bonne partie de sa vie à faire le con bourré sur scène et à se foutre sur la gueule avec son frère. Et à ce point, ce n’est pas de la malchance, mais un refus (cf. ses propos sur sa carrière). N’empêche, si on prend soin d’écouter les albums, toutes périodes confondues, il y a toujours ici et là de sublimes chansons, des perles noyées… Et le dernier, « Phobia », ne fait pas exception. Pour toutes ces raisons, un entretien avec Ray Davies, ne peut pas être l’interview de plus d’un marchand essayant péniblement de nous vendre sa soupe. C’est un plaisir.
– C’est votre premier album pour Columbia, ce changement est-il important?
– Je pense que la chimie entre une grosse compagnie et un artiste est importante. Je suis à l’aise avec la personne qui nous a signé de même que je l’étais avec Clive Davies chez Arista, alors que j’étais très mal à l’aise avec les gens de chez MCA. Le deal avait été passé par un manager qui nous quittait : j’ai lu dans « Billboard » que j’avais signé avec MCA ! Je ne les avait jamais rencontrés. A vrai dire, je pourrais être un écrivain existentialiste, je m’en fous… Mais je crois que pour rendre justice à l’ensemble de mon travail, je devais signer avec une compagnie qui sache comment le présenter au public. Nous vivons l’ère du catalogue. Quelqu’un me parlait de faire un coffret de mes chansons, me demandant comment je le concevrais, si par exemple, j’alignerais tous les hits. Non: je le ferais chronologiquement comme si c’était une histoire, l’évolution de ma façon d’écrire, parallèlement à ma vie et à la carrière du groupe. Cet album peut être vu comme un livre qui s’appellerait « Phobia », avec plusieurs histoires, l’une s’appelle « Still Searching », une autre « Scattered » ou encore « Only a Dream ».
– Vous êtes souvent cité comme une influence majeure. Êtes-vous intéressés par certains nouveaux groupes ?
– C’est agréable quand quelqu’un se réfère à nous. Il y a beaucoup de bons groupes. Je suis parfois un peu … désolé pour eux, car ils arrivent droit dans ce monde du « packaging ». Je suppose que nous avons été « packagés » aussi, cette photo le prouve (il me montre une photo ridicule du groupe vers 1965), mais d’une façon innocente. Ce n’est pas leur faute, mais, en particulier avec les vidéos, je trouve qu’ils se soumettent à ce conditionnement, ils acceptent d’être des produits. C’est probablement la seule différence entre eux et moi. Mais il y a des bonnes choses. Nirvana, évidemment, j’aime leur single, pas tout l’album…
– Sur votre EP paru l’année dernière, « Did Ya » sonnait comme un « Classic Kinks »… C’était un clin d’œil ?
– C’était volontaire. Une parodie de nous-mêmes. Cette chanson parle de Londres aujourd’hui. Je marchais dans King’s road, je regardais autour de moi, c’était en gros la même chose qu’avant, mais américanisé, avec des McDonalds. Et je pensais « Les swingin’ sixties ont-elles réellement existé, ou n’était-ce que quelques clichés préfabriqués pour magazines, qui ont fait le tour du monde ? ». Ça parle de choses que nous aurions du voir arriver : « As-tu jamais pensé que le monde deviendrait aussi dingue, avec tous ces gens dormant dans la rue, retournant les poubelles pour trouver de la nourriture ? ».
– Sur « Phobia », il y a cette chanson, « Hatred », chantée avec Dave. Est-ce réellement la haine qui vous fait rester ensemble ?
– C’est humoristique, avec le sous-titre : » La haine (un duo) ». Quelquefois oui, avec Dave, c’est la haine qui nous réunit. Une nuit, après avoir fait de super parties de guitares, il m’a rendu fou… On était dans ce restaurant, avec une bouteille de vin, et c’est sorti tout d’un coup : »J’aimerais que tu tombes là, raide mort, et que tu ne te relèves jamais ». Le lendemain matin, j’y repense, et je trouve ça drôle… Difficile de se relever une fois mort, n’est-ce pas ? C’est d’une telle stupidité, comme cette double négation dans la chanson : je dis « tu me hais » et il répond « et je te hais » !Mais les gens adorent les malheurs des autres… Et mon malheur à moi, c’est de jouer dans un groupe avec mon frère ! « Hatred » pourrait aussi bien être une histoire d’amour. J’adorerais voir Sonny & Cher en faire une cover.
– Sur cet album, vous jouez des claviers, Ian Gibbons n’est plus avec le groupe ?
– Non, nous avons un nouveau clavier, pour la scène. J’en joue sur le disque, oui, je l’avais déjà fait sur « Low Budget ». J’ai appris ça de Mort Schuman (!). C’était dans les sixties, je n’avais pas écrit un hit depuis trois mois. Mon manager était très inquiet, alors ils m’ont envoyé Mort Schuman ! Il est venu chez moi, il s’est assis et il m’a dit : « Écoute, Ray, c’est clair, tu ne sais pas jouer de piano. Moi non plus. Mais, même s’ils enlèvent ta partie au mixage, elle y est encore. Parce que c’est elle qui donne le drive du morceau, et les autres jouent en fonction de ça. » Et j’ai eu envie d’y revenir. C’est comme mon jeu de guitare. Les songwriters sont rarement des virtuoses, mais retirez leur instrument, et quelque chose manque. Chrissie Hynde est comme ça. Chris Thomas, son producteur, enregistrait toujours sa guitare en premier, parce que toute l’énergie venait de là.
– Vous allez tourner, rejouer en France ?
– Oui, nous allons faire quelques dates. Je pense qu’à Paris, il y aura une sorte de concert surprise, probablement deux fois, dans deux endroits très différent. Ça va être amusant. J’ai très envie de jouer ici. Pour moi, il n’y a pas que faire des disques et les sortir. Vous savez, ça m’a pris deux ans pour réaliser celui-ci, j’ai mixé certaines chansons quatre fois! Mais je ne dirais pas lesquelles…
– Vous avez toujours des projets extra-Kinks ?
– Oui, j’écris aussi une musique pour un ballet, un instrumental. J’aime avoir des projets dans différents domaines, je vais probablement faire un album solo, j’ai un tas d’idées en réserves pour des chansons qui ne sont pas forcément pour les Kinks. « Phobia » est un disque des Kinks, mais il y a quelques chansons, comme « Still Searching », qui vont dans une direction que j’aimerais vraiment pousser plus loin. Il ne s’agit pas d’en faire un méga-événement, simplement un disque humble et honnête. Juste moi, ma guitare et quelques musiciens.
– Au cinéma ?
– J’aime la réalisation. Mais j’ai perdu mes illusions avec tous ces films venant d’Hollywood. Je ne devrais peut-être pas le dire, mais je suis en train de discuter avec Wim Wenders. Il est possible que l’on travaille ensemble. Une collaboration.
– Il m’a toujours semblé qu’il y avait un univers commun à vos chansons et à un certain cinéma anglais des sixties, « Samedi Soir, Dimanche Matin », « La Solitude du Coureur de Fond », etc…
– C’est très étrange que vous mentionniez « Samedi Soir, Dimanche Matin », parce qu’Albert Finney est venu nous voir jouer à New York, juste au moment de notre nomination pour le Hall of Fame. Il est venu vers moi, et il m’a dit : « Ray, on l’a fait ! Je l’ai fait avec mes films, tu l’as fait avec ta musique. » . Il était saoul… Il est toujours saoul! Mais je n’avais pas réalisé ce rapprochement. C’était un esprit, une sorte de mouvement mondial. Prenez le héros de « la Solitude… », le système voulait l’intégrer, ils savaient qu’il pouvait gagner. Dès le premier virage, il est en tête, mais il sait que s’il arrive premier, il sera détruit par le système. Alors il s’arrête. De bien des façons, il y a un parallèle à faire avec ma carrière et celle des Kinks.
– Allez vous tourner vos vidéos vous-même ? Croyez-vous que ce puisse être une forme d’art, ou n’est-ce que du marketing ?
– Je ne voulais pas les diriger, j’ai demandé à Wim de le faire, mais il finit son film pour Cannes, « Les Ailes du Désir II », qui a l’air fantastique, de la façon dont il le raconte. Si je pouvais, le vrai fun, ça serait d’avoir Alfred Hitchcock pour réaliser « Phobia »! Je suppose que je devrais me rabattre sur Stephen King, ou John Carpenter… J’adorerais penser que c’est une forme d’art. Parfois… Mais c’est réellement un outil de marketing, malheureusement.
– Écrivez-vous, en dehors des chansons et des scripts ?
– Je viens juste de finir mon premier livre, les premières épreuves. Mes éditeurs veulent le publier cette année… Ils sont fous! Mais je l’aime bien, vraiment. J’ai toujours écrit, différentes choses, des nouvelles, mais je garde ça bien caché. J’ai écrit un script complet pour « Celluloid heroes », et aussi pour « Muswell Hillbillies ». Parfois, c’est pour ça que ça nous prend du temps de faire un disque… En fait, je donnerais n’importe quoi pour avoir écrit les paroles et la musique de « Jérusalem ». Le texte est de William Blake… En cinq minutes, tout son être passe dans ces mots. Comme Hemingway… « The Old Man and the Sea », ce petit bouquin modeste. Après toutes ces années de folies, il finit avec 90 pages de pure magie.
– Vous-même, pensez-vous avoir réussi quelque chose qui restera ?
– Si je meurs demain… Je voudrais que la BBC joue « Waterloo Sunset »… (rêveur) Mais les connaissant, il joueront probablement « Sunny Afternoon ». Et peut-être en France, ce sera « All Day and All of the Night », parce que c’est une chanson cool…
– Et d’autres, « You Really Got Me ».
Pourquoi pas… En fait, peut-être l’ai-je déjà écrit, mais je crois toujours qu’à l’horizon, au bout de la route, il y a ce petit point, mon « Vieil Homme et la Mer ». J’aimerais bien pouvoir l’atteindre.