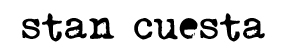La chanson française n’existe pas (ou les enfants de Léo Ferré).
Stan Cuesta. 2019.
La chanson française n’est pas un genre musical. Elle a toujours mangé à tous les râteliers, au fil de l’évolution des modes et des mœurs : jazz, pop, folk, rock, reggae, musiques du monde (quoi que cela veuille dire), hip-hop, electro, etc. Sa spécificité, si elle en a une, ce sont ses textes, grands ou petits.
On a souvent dit que la chanson française était un cas à part dans le monde, cette fameuse « exception culturelle » qui ferait de la France – cocorico – le pays ayant le mieux résisté à la domination anglo-saxonne, en préservant une tradition forte consistant à chanter dans sa langue et – mesure de tout ça – un marché résistant à l’envahisseur. Comme pour le cinéma.
Mais si la France a résisté, c’est surtout par défaut, grâce à l’incapacité des Français à parler et à chanter en anglais, contrairement par exemple aux Allemands ou aux Scandinaves (Abba, etc.). L’exception culturelle est en grande partie née de ce handicap. Récemment, quelques jeunes s’y sont mis (Phoenix, Justice, ce genre) mais c’est rare. Et surtout sans intérêt. Les yéyés, eux aussi, viennent de là, ayant bâti leur carrière sur l’adaptation de succès originaux américains et anglais soigneusement ignorés par les médias à la solde des maisons de disque, pour que le public ne puisse pas faire la comparaison (franchement pas à leur avantage).
Mais à cette époque, on faisait la distinction entre chanson à texte et variété. Dans les années soixante, dont on a encore du mal à sortir, il y avait d’un côté les grands anciens de la chanson « noble » – les incontournables Brel, Brassens, Barbara, Ferré, et les moins souvent cités Ferrat ou Béart. De l’autre les yéyés, qui n’ont pas tout à fait fini de truster nos écrans, antennes et consciences, toujours là, même – surtout – quand ils sont morts : Johnny, Eddy, Dick, Dutronc, Hardy, Sylvie, etc.
Aujourd’hui, la frontière n’existe plus. Mais surtout, la chanson française en tant que telle n’intéresse plus personne, ou presque plus. L’âge d’or est passé. Les livres sur le sujet ne se vendent pas, à part quelques monographies de vedettes. Les disques non plus. On a été obligé d’imposer des quotas pour la maintenir sous perfusion, aidé par quelques journaux et radios (France Inter, Télérama) ainsi que tout un attirail de subventions diverses.
Pourtant, on vit encore sur ce mythe des « pères fondateurs ». Mais Brassens, combien de division ? Maxime Le Forestier, Philippe Chatel… Fermez le ban. Brel ? Personne n’ose plus sa démesure. Barbara ? Une nuée de chanteuses qui ne lui arrivent pas à la cheville.
Il y a peu, le modèle absolu, c’était Gainsbourg, dont la carrière même est à l’image de la chanson française, qui emprunte ses musiques un peu partout : au jazz de Boris Vian dans les années 1950, à la pop et à la musique afro-cubaine dans les sixties, au rock anglais au cours de la décennie suivante, au reggae puis enfin au funk new-yorkais dans les eighties. On sort tout juste de cette période où Gainsbourg a été l’influence prépondérante et incontournable de tout le monde, dans le monde entier (de Benjamin Biolay à Beck…), notamment sa période anglaise, avec des albums qui furent – ironie du sort – de retentissants échecs à l’époque (Melody Nelson, L’Homme à tête de chou).
Reste Léo Ferré. Depuis quelques temps, c’est sa descendance, revendiquée ou non, qui semble la plus intéressante. L’influence de Ferré, bien sûr, ne date pas d’aujourd’hui. D’Higelin à Noir Désir en passant pas Bashung, Thiéfaine, Lavilliers, Manset et quelques autres (notez comme on omet les prénoms de ces artistes à partir d’un certain niveau de notoriété), elle a toujours été présente. Il s’agit presque toujours de « fous chantants » pour reprendre l’expression de Trenet, les seuls à offrir une réelle originalité – bien souvent via une certaine démesure – dans le paysage quelque peu plan-plan de la chanson ou de la variété française. Hors cadres, borderlines, pas très radiophoniques, sauf de temps en temps, à la faveur d’une méprise (« Il voyage en solitaire », « Gaby, oh Gaby », « Champagne », « Le Vent nous portera », etc.), exactement comme Ferré, dont le grand public se souvient pour de mauvaises raisons, ne connaissant de lui, au mieux, que trois tubes (« Jolie Môme », « C’est extra », « Avec le temps »), la partie émergée de l’iceberg.
Le temps rend toujours justice aux vrais artistes. Les premiers héritiers de Ferré s’en sortent bien, même s’il leur a fallu attendre. Bashung, après des années de galère, a fini par marquer l’Histoire. Thiéfaine a mis encore plus longtemps, lui qui connaît enfin une certaine reconnaissance critique après quarante années de purgatoire, voire d’indifférence totale. Brigitte Fontaine n’est sortie que tardivement de l’underground. Higelin n’est pas encore réhabilité comme il le devrait, mais c’est en bonne voie…
Mais c’est surtout aujourd’hui, plus de vingt ans après sa mort, que Ferré est omniprésent, même sans être nommé expressément, dans la production de jeunes artistes. Pourtant, la plupart sont totalement ignorés du grand public. A qui la faute ? Aux médias, qui nous vendent une soupe populaire assez insipide. Face au rap omniprésent, devenu la musique de la jeunesse, quelques personnes se voulant raffinées portent aux nues de jeunes chanteuses et chanteurs sans originalité, totalement inoffensifs et donc parfaitement radiophoniques, en pensant sauver la grande tradition de la chanson française. Comme la critique n’existe plus (on encense ou on ignore, ils n’y a plus rien entre les deux), aucune voix ne s’élève pour tempérer un enthousiasme de commande quelque peu frelaté. Il n’y a plus personne pour nous dire qu’Eddy de Pretto ou Clara Luciani (au hasard, no hard feelings, comme on dit) ne sont pas des génies, qu’ils ne sont pas les dignes héritiers des « grands anciens », que leur soupe est au mieux très digeste, probablement bio, et politiquement parfaitement correcte. Que malheureusement, ce n’est pas comme ça qu’on fait de grandes chansons – françaises ou autres – ni qu’on touche réellement les cœurs et les esprits. Mais c’est peut-être la marque d’une époque et d’un certain public bien spécifique, urbain, branché, néo-bourgeois et frileux, qui se rassure en écoutant ces filets d’eau tiède et en consommant des bières artisanales à sept euros le verre en face de son espace de co-working. Une « élite » pas forcément très représentative, mais qui tient les rênes des médias.
Où sont donc les enragés de la chanson, les héritiers de Léo Ferré ? Ils sont là, bien souvent en province, sous nos yeux, ou plutôt sous nos pieds, dans la boue (« on dirait qu’ça t’gêne »), dans l’underground… Au sens propre, puisqu’on en a récemment découvert certains grâce à un collectif étonnant qui s’appelle justement La Souterraine. Benjamin Caschera, l’un de ses fondateurs, en explique le fonctionnement : « C’est une plateforme qui répertorie l’underground de France. De la musique francophone ou instrumentale, et quelques langues minoritaires, en gros tout ce qui n’est pas chanté en anglais (…) C’est un site internet, une espèce d’archive ou une médiathèque en ligne, où tout est disponible gratuitement ou à prix libre, les gens mettent ce qu’ils veulent. Il y a 500 groupes hébergés qui ont au moins un site réservé. Ça n’est pas un label, ça n’est pas un producteur, mais un hébergeur d’auto-producteurs, ou de petits producteurs autonomes. »
Pour les cinquante ans de Mai 68, dont elle se sent proche (« Pour l’ambiance de liberté, artistique et par rapport au marché, pour renverser la situation de l’industrie telle qu’elle fonctionne… Il n’y a que dans le rap qu’il y a des trucs aussi engagés, anticapitalistes »), La Souterraine a sorti un disque intitulé C’est extra, 13 reprises de Léo Ferré, qui a permis de découvrir au moins deux talents hors-normes comme on n’en entend plus assez : Gontard et PR2B.
Sur ce disque, Gontard reprend « L’Opéra du pauvre », un titre issu d’un album tardif assez méconnu de Ferré, violent et superbe. En creusant, on remonte aux productions personnelles de cet artiste, et c’est un choc. Un nouveau disque vient tout juste de sortir, Gontard 2029, une espèce d’album concept sur sa ville, Romans-sur-Isère, rebaptisée Gontard-sur-Misère. C’est indescriptible de justesse, de puissance, de drôlerie, de désespoir. Gontard ne chante pas vraiment, comme tous ceux auxquels nous nous intéressons ici, bizarrement. Comme si l’on ne pouvait plus chanter de jolies mélodies pour décrire le monde d’aujourd’hui… Il pose sa voix implacable sur des musiques décalées, comme le faisait justement Léo Ferré sur Il n’y a plus rien (1973), l’un de ses chefs-d’œuvre absolus.
PR2B reprend elle aussi « L’Opéra du pauvre » en concert, avec l’Extragroupe, une formation montée pour tourner avec les chansons de cet album. Une vidéo live existe sur youtube, totalement électrisante. Ce petit bout de femme possède un charisme hallucinant, on a l’impression qu’elle entre en transe au fur et à mesure qu’elle débite le texte de Ferré. On ne comprend pas tout, parfois on ne comprend rien du tout (ce qui est souvent le cas avec Ferré) mais c’est magnifique. Enfin un peu d’émotion et de mystère.
L’impression d’avoir découvert une perle, une future grande, est renforcée par l’écoute du titre qu’elle reprend sur C’est extra, « Tu ne dis jamais rien », dont elle donne une lecture à la fois fidèle et novatrice, grâce à l’accompagnement sobre et froid d’une musique électronique qui rend le texte encore plus prenant. Mais c’est la voix de Pauline – son prénom pour l’Etat Civil – qui nous transporte. La version originale « chantée » par Ferré (sur La Solitude, 1971) était d’une force incroyable. On est presque gêné de s’apercevoir que PR2B a fait encore plus fort. La Souterraine ne s’y est pas trompée : elle a positionné ce titre en ouverture de l’album et place en cette artiste de grands espoirs. Pauline n’a même pas encore publié d’album, mais atomise déjà à l’avance toute la concurrence. PR2B ira loin.
Rap ou chanson ? Loin des maniérismes fatigants du rap, loin de la médiocrité mièvre de la chanson du XXIème siècle, avec PR2B comme avec Gontard, on est ailleurs, dans la prolongation d’un style inventé par Ferré, parlé sur fond musical.
Mais il faut rendre à César… Ces deux jeunes artistes se situent dans la tradition de deux autres grands auteurs et chanteurs issus de l’underground, versant rock cette fois-ci, plus que jamais d’actualité.
Michel Cloup, d’abord, qui depuis les années 1990, au sein de son groupe mythique, Diabologum, a inventé une nouvelle forme, surimposant des textes poétiques et/ou engagés sur une musique rock puissante, à la limite de l’expérimental, dans la veine de formations américaines comme Sonic Youth. Il faut absolument écouter le troisième album du groupe (#3, paru en 1996), sur lequel il met entre autre en musique le monologue de Françoise Lebrun extrait du film La Maman et la putain de Jean Eustache, une réussite absolue. A la séparation de Diabologum, ses deux leaders ont formés deux groupes incontournables : Programme (le véhicule hyper violent d’Arnaud Michniak, des textes implacables sur une musique minimale) et Expérience (emmené par Cloup, résolument plus rock et touchant). Aujourd’hui, Michel Cloup sort un quatrième disque en duo avec le batteur Julien Rufié, Danser danser danser sur les ruines, dans une indépendance totale, offrant une musique et des textes combatifs, envoûtants, émouvants, comme on n’en entend nulle part ailleurs.
Diabologum avait été découvert par le défunt label nantais Lithium. Michel Cloup Duo est aujourd’hui distribué par le label nancéen Ici d’ailleurs, qui, à bien des égards, a pris la relève en produisant et distribuant nombre de disques qui ne sortiraient pas sans lui…
C’est notamment le cas des différents projets de Pascal Bouaziz, peut-être le plus important de tous les artistes intéressants et méconnus évoqués ici. Vingt ans que son groupe, Mendelson, qui a également débuté sur Lithium, publie des albums superbes remplis de chansons ne ressemblant à rien d’autre de ce qui se fait par ici (écoutez par exemple « 1983 (Barbara) » sur Personne ne le fera pour nous, 2007) : belles, poétiques, drôles et intelligentes, sur fond de rock impeccable, pétri d’influences anglo-saxonnes, qui ne rechigne pas à lorgner du côté du free jazz ou de la musique expérimentale. Le dernier album du groupe, Sciences Politiques (2017), est une merveille : douze adaptations en français – parfois très libres – de grandes chansons « politiques » anglo-saxonnes (de Bruce Springsteen à Alan Vega en passant pas Robert Wyatt ou Lou Reed). Un sommet… passé presque totalement inaperçu.
L’insuccès chronique de son groupe – malgré les louanges unanimes de la critique – a poussé Bouaziz à lancer un projet parallèle absolument radical et jouissif, Bruit Noir, un duo dont il écrit les textes et Jean-Michel Pirès (batteur de Mendelson) les musiques. Leur deuxième album, II/III, vient de paraître, et il explose littéralement à la figure des auditeurs : le « Bruit Noir », ce sont ces pensées inavouables qu’on a tous et que Bouaziz livre avec l’humour du désespoir, à la fois grinçant, caustique, poétique et hilarant, sur fond de musique industrielle froide et terrifiante. Autant dire que le résultat est inouï. Incroyablement, le succès semble enfin être au rendez-vous – du moins en concert et sur disque, on n’entend pas encore ces chansons sur RTL, ni même sur France Inter…
Est-ce encore de la chanson française ? Du rock français ? Du rap ? Rien de tout cela, ou tout cela à la fois. Pas plus que Gontard, PR2B ou Cloup, Bouaziz ne chante. Mais tous écrivent des textes forts, en français. La question, finalement, a peu d’importance. La chanson française n’existe plus. Ceux qui chantent en français n’ont plus rien à dire. Ceux qui ont quelque chose à dire ne chantent plus. Ils parlent, ils assènent, ils crient. Cela dit sûrement quelque chose de notre époque.
ArtPress2. La Chanson Française. lire +
© 2019 all rights reserved stan cuesta. Mentions Légales Design by agnes al.