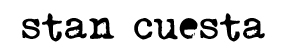Interview de Joan Baez
Stan Cuesta. 2019
Le Farewell Tour de Joan Baez touche à sa fin. Entamée l’année dernière, cette tournée d’adieu n’a cessée d’être prolongée. Elle se terminera cet été, avec notamment cinq concerts en France : Saint-Malo le 9 juillet, Carcassonne le 15, Vichy le 16, Vienne le 21 et Perpignan le 22 !
En février, Joan Baez faisait ses adieux à l’Olympia. Nous l’avons rencontrée un après-midi, juste avant l’une de ses dernières et fabuleuses prestations dans cette salle mythique qui lui a fait, comme toujours, un triomphe. L’occasion de revenir sur la carrière d’une chanteuse hors du commun, mais aussi d’une artiste engagée comme on n’en fait malheureusement plus…
Vous avez été très tôt sensible à l’injustice dans le monde ?
Quand j’avais huit ans, mes parents sont devenus quakers. J’entendais ces discussions sur la violence et la non-violence à la maison, où il y avait toujours beaucoup d’étudiants. Pour je ne sais quelle raison, j’adhérais à leur pacifisme, alors que j’étais très jeune. Puis, quand j’ai eu dix ans, nous avons déménagé à Bagdad, et j’ai vu des choses que la plupart des enfants américains ne voient jamais. Tout cela, additionné à ma personnalité, a fait que j’ai adopté ces idées…
Oui, deux chansons, mais ça a été très fort. C’était il y a soixante ans, il y a plein de choses de cette époque dont je ne me souviens pas bien, mais de ça, si. C’était ma première grande foule… J’étais si nerveuse que mes genoux s’entrechoquaient, littéralement. J’étais sous la rampe qui conduisait à la scène et je tremblais. Ça a toujours été comme ça, avant de monter sur scène et de m’approcher du micro, mon cœur cogne. Ensuite, quand je commence à chanter, ça se calme.
Il était connu et respecté dans le milieu folk, et aussi dans les night clubs, notamment le Gate of Horn, le club le plus célèbre de Chicago, le seul dans lequel j’aie joué…
C’était son club, oui. J’avais 18 ans. J’ai dit : « C’est absolument impossible que je joue, il y a de l’alcool ! » Et là, j’ai entendu mes parents dire à Grossman, « C’est juste qu’elle a peur ! » Ils ne savaient pas que je les avais entendus, j’ai dit que j’avais changé d’avis, que j’allais y aller et voir comment c’était. Bob Gibson était là, c’était vraiment une atmosphère de bar, les gens se droguaient, je ne comprenais rien à ce qui se passait, je n’étais pas à l’aise…
C’est vrai, mais il est mort jeune. Et il n’a jamais été au premier plan. Il était adorable, très doux. C’est lui qui m’a appris « John Riley », une magnifique chanson folk [Qu’elle enregistrera sur son premier album en 1960, suivie par Judy Collins en 1961, The Byrds en 1966, etc.]
Oui, c’était assez réaliste. Ils ont fait du bon travail. Je ne l’ai pas aimé tant que ça, mais j’ai été fascinée qu’ils recréent tout ça…
Oh oui, il m’a fait une telle impression. Dans mon lycée, il y avait des réunions tous les ans au sujet de la politique et de la non-violence. Cette année-là, ils avaient invité King. Il a commencé à parler et… A 16 ans, je savais déjà que la non-violence était ma voie, j’avais étudié Gandhi, mais cet homme, qui parcourait le Mississippi avec sa femme, incarnait tout ce que j’avais lu. J’ai pleuré, pleuré, les autres gamins pensaient que j’étais folle ! Il avait un immense pouvoir.
Peu après, il y a eu cette bombe dans une église de Birmingham qui a tué quatre fillettes noire. Votre beau-frère, Richard Farina, a écrit « Birmingham Sunday » que vous avez enregistrée. Parlez-nous de lui.
C’était un excentrique. Il se prenait pour quelqu’un qu’il n’était pas tout à fait… Je l’aimais bien. Sur la fin, un peu moins, parce que je ne pense pas qu’il ait bien traité ma sœur, il avait un ego trop important. On se retrouvait sur certaines choses, on piquait des fous rires, on prenait des accents, tout le monde en avait marre, ça n’en finissait jamais. Mais j’étais toujours un peu… mal à l’aise qu’il ne s’occupe pas bien de Mimi.
Non, mais un homme qui travaillait sur ce film a dit que Spike Lee commençait toutes ses journées avec cette chanson.
Je me souviens d’un moment particulier où des blancs nous lançaient des pierres… Je ne faisais pas attention. J’étais avec mon ami Ira Sandperl, qui est blanc et juif, on marchait sur une route. Des enfants noirs sont sortis pour nous protéger, et un gamin lui a dit, « Pourquoi faites-vous ça ? Ils pourraient penser que vous êtes un manifestant ! » Et Ira lui a répondu, « C’est vrai, mais ils pourraient aussi penser que tu es noir ! »
Quand j’avais 15 ans, il m’a fait découvrir Gandhi et Lao Tseu. Je lisais beaucoup à l’époque. Après quelques années, je me suis dit qu’il serait bon de rassembler beaucoup de gens, pour avoir une dynamique différente, qu’ils posent des questions auxquelles je n’aurais pas pensé… Je savais qu’Ira était très charismatique et qu’il s’y connaissait, c’est comme tout que ça a commencé.
Au début, j’ai dû beaucoup m’impliquer, parce que les voisins n’en voulaient pas… On a dû se battre contre les gens du comté. Le plus drôle, je ne crois pas que j’aie jamais raconté ça, c’est que ceux qu’on inquiétait le plus habitaient de l’autre côté de la rue, et vivaient littéralement sur leur pelouse pour voir si quelque chose de terrible se passait. Le mari, c’était mon vétérinaire… Il me disait, « pourquoi venez-vous chez moi ? » Et moi, « parce que vous êtes un merveilleux véto ! » Un jour, je lui ai demandé, « quel est le problème, exactement ? » Le problème, c’était qu’ils voyaient des motards devant chez eux, et qu’ils avaient entendu dire que les Hell’s Angels mangeaient les chiens !
Je pense que tout a basculé quand la guerre du Vietnam a pris fin. Les gens dont la philosophie avait changé à cause d’elle ne savaient plus quoi faire… Même pour moi, ça a été un gros problème. Chaque jour, je luttais pour les Droits Civiques, contre la Guerre du Vietnam, je savais ce que j’avais à faire. Quand ça a été terminé, j’étais perdue !
J’étais complètement terrifiée. Mais on s’habitue. On mesure la distance à laquelle sont les avions. Quand ils sont loin, ça va, quand ils se rapprochent, on se dit, « oh mon Dieu, pas par ici ! » Ensuite, on se sent coupable, parce que si ça n’était pas ici, c’était ailleurs…
Ce n’est pas un album commercial, mais il a été important. Je l’ai fait en quatre jours, avec mon petit magnétophone… Juste des sons. J’ai pensé que ça valait le coup de garder tout ça.
J’étais à Rome, seule, dans un hôtel magnifique, et mon ami, Giulio Colombo, un réalisateur de télévision, s’est pointé avec Morricone, qui m’a dit, « Des gars écrivent une histoire, nous avons besoin de musique, voulez-vous la faire ? » Comme je n’en avais jamais fait, j’ai dit, « Je ne sais pas faire ça. » Il m’a répondu, « Bien sûr que si ! » Il m’a raconté l’intrigue, et j’ai écrit trois ballades pour le film. Puis, après-coup, il m’a dit, « Il nous faut une petite chose en plus. Ça fait comme ça : ‘da dada dadadada da’ ». Moi : « Ok, donnez-moi une demi heure. » Quatre lignes de texte. C’est tout ce qu’il fallait.
Je ne sais pas ! La magie de l’époque, de la mélodie… Parce que les Français ne connaissent que ça, l’ad lib sans paroles. Le compositeur est un génie. Le film a été énorme, du moins en Italie. Aux Etats-Unis, il n’a pas marché, ce qui prouve à quel point il est bon !
Le premier soir de cette dernière tournée, à l’Olympia, j’ai oublié de la chanter. J’ai fait mon rappel avec « Le Temps des cerises » et je suis repartie dans les loges… Là, j’ai entendu toute la salle chanter « da dada dadadada da ». Oh merde ! J’ai dû y retourner… J’ai réalisé que je pouvais me faire assassiner si je ne la faisais pas !
Mon unité de mesure est très élevée. J’ai écrit quelques bonnes chansons. Certaines sont meilleures en tant que poèmes, comme « Luba the Baroness » [sur Blowin’ Away, 1977], mais si on les mesure par rapport à un standard universel, il n’y en a qu’une : « Diamonds And Rust »…
Et bien, ça parle de lui !
Oui, en fait, je suis probablement dedans… Dylan tournait tout le temps. Il se croyait metteur en scène. Il se baladait partout avec sa caméra, c’était affreux…
Sur la première tournée, oui, celle avec les fleurs dans le chapeau, etc. Mais la deuxième était plus…
[Elle éclate de rire] Ce n’est pas le mot ! Disons que ce n’était plus aussi nouveau.
Scorsese va probablement utiliser les rushes de Renaldo & Clara ?
Mais ce n’était QUE des rushes ! Je l’ai vu, c’était épouvantable.
Non, il n’y en a pas ! Mais peut-être que c’était l’idée. Je suis sûre que le film de Scorsese sera bon.
Oui, je pense que la musique m’a dépassée. Les choses avaient changé et pas moi. Il m’a fallu longtemps pour le comprendre. Et après avoir réalisé que ma carrière était dans la merde aux Etats-Unis, quand j’ai voulu changer, je ne trouvais pas la bonne personne…
C’était difficile pour tous les artistes des sixties…
Très peu s’en sont sortis. Et je n’y serais sans doute pas arrivée sans Mark Spector. Il m’a dit : « Pourquoi veux-tu un manager ? » Et j’ai répondu, « Je suppose que je veux durer… Je n’ai pas besoin des teenagers, mais j’aimerais arriver au niveau que je pense pouvoir atteindre. » La plupart des mecs auraient dit, « Signez ici ! » Il a fait, « ça ne va pas être facile. » [rires]
Oui, c’était une idée brillante. Ça m’a redonné de la fraîcheur. Quand vous êtes avec des gens plus jeune, ça vous donne l’impression de rajeunir !
Vous avez fait l’ouverture, à 9h du matin !
Il n’y avait pas de place pour moi, à part au tout début… Pour jouer là-bas, il fallait être rock’n’roll. Moi, j’étais seule avec ma guitare, donc j’étais très heureuse comme ça. Bill Graham était furieux, il voulait que je la ferme : « Tais-toi et chante ! » Il se bagarrait toujours avec Mimi à ce sujet. Il disait, « Vous les filles… Toi et ta sœur ! » C’était un gros macho…
Qu’est-ce qui vous a poussé à y aller ?
J’avais pris la décision d’arrêter tout ça un moment, de me concentrer sur la musique. Et puis, j’ai reçu un coup de fil d’un représentant d’une grande organisation humanitaire. Il était avec des habitants de Sarajevo, des bombes tombaient tout autour d’eux et il m’a dit, « Est-ce que tu viens ? Ces gens ont besoin que quelque chose leur rappelle qu’il y a un monde au dehors. » Et j’ai dit, « Bien sûr. » Je n’y ai pas réfléchi à deux fois, j’y suis allée…
Pourquoi est-ce toujours vous qui y allez ?
J’ai ces deux dons principaux : pouvoir chanter n’importe où, sans rien, et le désir de faire ce que je fais. Les gens me disent, « tu fais des sacrifices »… Pour moi, le sacrifice, ce serait de ne pas pouvoir le faire.
Et maintenant ? Où est la relève ?
Ce dont il faut se souvenir, c’est qu’en une dizaine d’années, il y a eu les Rolling Stones, les Beatles, Bob Dylan, Joni Mitchell, Joan Baez, Leonard Cohen… Ça n’arrivera plus jamais ! Alors quand vous dites, « Et maintenant ? », en prenant comme référence ces années-là… Il est presque impossible d’écrire « We Shall Overcome » ou « Imagine » aujourd’hui. Elles venaient de ce qui ce passait. Et de génies. Et c’est un problème. Beaucoup de gens écrivent des chansons, certaines sont bonnes, mais personne n’a écrit l’équivalent de « Blowin’ In The Wind ». La musique est partout, mais il lui manque ce lien qui fait que tout le monde chante ensemble.
Il a été nommé aux Grammys. Etes-vous…
Intéressée ? Non… ça ne me parle pas. Je vais vous dire ce qui me parle : j’ai participé à une compétition de peinture, je suis en demi-finale, on n’est plus que 100 sur 2600 ! Si j’arrive en finale, mon tableau sera exposé à la National Gallery pendant un an. Ça, ça m’enthousiasme ! Peut-être parce que c’est nouveau…
© 2019 all rights reserved stan cuesta. Mentions Légales Design by agnes al.